Le futur sera féministe : Lauren Bastide nous explique pourquoi dans son dernier livre
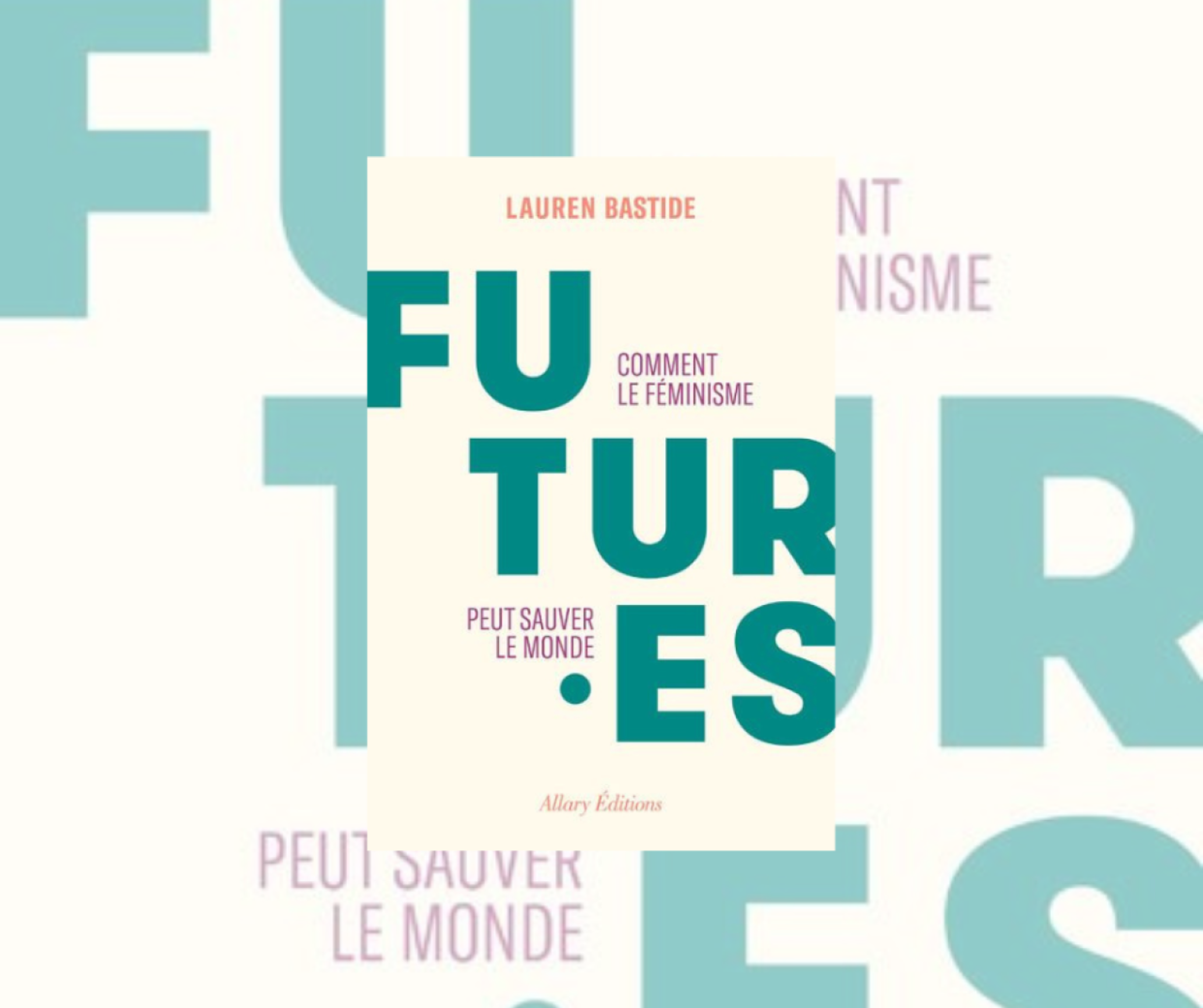
FÉMINISME - On se lève, on se casse... Et après ? Cinq ans après les prémices de la révolution #MeToo, quelles observations tirer d’un monde où se multiplient les crises ? Alors que s’exacerbent les inégalités, quelles projections positives malgré tout se profilent pour bâtir une société plus égalitaire et inclusive ? Et surtout, pourquoi le féminisme, mouvement pluriel, tantôt loué, tantôt invectivé, plus que jamais nécessaire, sauvera ce monde qui brûle ?
Ces vastes questions se cristallisent dans Futur·es, le dernier essai de la journaliste Lauren Bastide, créatrice du podcast La Poudre. Un livre intime (dédié à sa soeur Julia, victime d’un féminicide) abordant aussi bien « l’affaire PPDA » que l’évidence de l’écoféminisme, le « berceau des dominations » qu’est l’inceste et « la puissance de la sollicitude », autrement dit de l’empathie. Soin qui n’implique pas de renier une autre force, celle de l’indignation, palpitant au fil de ces chapitres brassant une foultitude d’enjeux.
Lauren Bastide en est persuadée : le futur sera féministe ou ne sera simplement pas. À l’unisson du dernier roman de Virginie Despentes, son essai foisonnant concilie convictions personnelles et mobilisations plus globales, intime et politique, pour proposer un dialogue. Un appel à mieux écouter, comprendre, et faire résonner les voix qui portent la colère d’aujourd’hui.
L’autrice nous raconte tout.
Terrafemina : Futur·es apparaît comme un livre plus personnel que le précédent, Présentes (Editions Allary). Le percevez-vous ainsi ?
Lauren Bastide : Carrément. Je me livre beaucoup plus dans ce livre. Notamment car je me suis rendue compte que la meilleure façon de transmettre et d’illustrer toutes les théories féministes que j’aborde, c’était de partir de ma propre expérience.
Ce côté intime vient-il également d’une envie de faire le bilan, cinq ans après le lancement du mouvement #MeToo, et six ans après le premier épisode de votre podcast La Poudre ?
Plus que de bilan, je parlerais de prospective. La question que je me pose est : où est-ce qu’on va maintenant ? Comment on imagine la suite ? Comment on transforme l’essai ? Le livre s’ouvre sur le constat d’un effondrement humain, notamment symbolisé par la crise climatique et la montée du fascisme...
Mais à côté de cela, je trouve tellement d’espoir dans la pensée féministe, j’avais envie de le partager avec d’autres.
Dans ce livre, vous écrivez : « #MeToo m’épuise ». Précisément, c’est la médiatisation de ces récits qui vous épuise. Vous suggérez que les médias tendent à sexualiser le viol, à oublier que c’est « de la domination ».
Effectivement, je pense que les médias ont leur responsabilité là-dedans, dans cette mise en récit qui me dérange. Mais les médias sont le reflet de la société, et d’une pensée qui tourne beaucoup trop, autour du viol : « est-ce vraiment arrivé ? ». On va toujours remettre en question le viol, factuellement. À s’acharner sur cette question justement, on en oublie d’interroger ce qui se trouve autour du viol, ce qui lui a permit d’advenir.
À force de raconter des viols, on oublie de raconter tout ce qu’il y a autour. On oublie de rappeler que le viol est un outil de domination, qu’il peut être une arme de guerre, que le viol est une violence systémique qui s’exerce sur les minorités, les familles, les enfants.
Le futur féministe que vous esquissez passe par un questionnement de l’hétérosexualité. Une remise en cause que proposent de plus en plus d’essais, comme la collection de Victoire Tuaillon. Pourquoi est-ce un enjeu si considérable ?
Un mouvement majeur comme #MeToo pose un problème qui questionne directement l’hétérosexualité, en interrogeant un outil de domination hétérosexuel, puisque principalement employé par des hommes sur des femmes : le viol. Ce n’est pas un hasard si beaucoup de féministes (comme Victoire Tuaillon, Mona Chollet, Fiona Schmidt, Judith Duportail) se sont saisies de la question d’hétérosexualité. Le féminisme interroge les relations entre les hommes et les femmes. Donc forcément, il ne peut qu’interroger l’hétérosexualité.
Cette interrogation nous pousse à questionner le couple, la sexualité, mais aussi la maternité, les constructions culturelles... Cela n’est pas nouveau car le modèle hétérosexuel était évidemment le sujet des réflexions des autrices et militantes Monique Wittig et Christine Delphy dans les années 70.
Vous citez la romancière et militante féministe lesbienne Monique Wittig pour parler de « lesbianisme politique ». À savoir, être lesbienne en réaction au système hétérosexuel et aux violences qu’il engendre.
La notion de lesbiannisme politique et les travaux de Monique Wittig, reviennent sur le devant de la scène ces dernières années, dans les livres, sur Instagram. Je pense à la récente parution d’Emilie Noteris : Wittig, aux éditions Les Pérégrines, un très beau livre. On se remet, à l’instar d’une certaine frange des militantes des années 70, à envisager le lesbianisme comme manière d’échapper au sexisme. Et c’est vrai que c’est une solution valable !
Dans ce livre, j’explique comment au sein des féminismes actuels l’on voit s’opposer d’un côté des hétéro-réformistes qui cherchent à tout prix des moyens de faire corps social avec les hommes, et de l’autre un mouvement lesbien plus radical qui peut suggérer la sécession comme une solution politique valable.
Personnellement, j’aimerais qu’on arrive à accepter que ces deux mouvements coexistent, et qu’on éjecte pas du mouvement les positions les plus radicales justement, ce qui hélas est déjà arrivé dans l’histoire des féminismes.
Cette idée de coexistence évoque le Cher Connard de Virginie Despentes, qui démontre qu’on peut écouter l’autre sans renier sa « radicalité » féministe. De même, par-delà les théories que vous brassez, vous écrivez : « Je voudrais écouter les hommes ».
En fait, plus que d’écouter les hommes, j’aimerais les interroger. Je ne veux pas leur laisser le contrôle d’une narration qui servirait avant tout leurs propres intérêts, j’aimerais les inciter à prendre conscience de leur approche du genre, de cette évidence : On ne naît pas homme, on le devient.
On parlait d’hétérosexualité et je constate que la plupart des hommes qui interrogent frontalement leur performance de la masculinité ne sont pas hétéros : le cinéaste Xavier Dolan, l’écrivain Edouard Louis, le médecin Baptiste Beaulieu, très actif sur les réseaux sociaux... Quand on sera parvenues à convaincre un maximum d’hommes que le sexisme les concerne aussi, dans la mesure où il en sont les acteurs, on arrivera à avancer.
J’avais justement évoqué cette idée « d’écouter les hommes », ou plutôt de les confronter à leurs généralités pour admettre leurs erreurs, à Virginie Despentes... Et elle m’avait répondu : « on entend quand même beaucoup les hommes ! ». Leurs états d’âme, leur mal de vivre... Depuis que la littérature est littérature, notamment. Et elle a clairement raison sur ce point !
Vous ne pouvez visionner ce contenu car vous avez refusé les cookies associés aux contenus issus de tiers. Si vous souhaitez visionner ce contenu, vous pouvez modifier vos choix.
À voir également sur Le HuffPost :
Lire aussi

 Yahoo Actualités
Yahoo Actualités 
