Retour sur quelques faux pas de la science
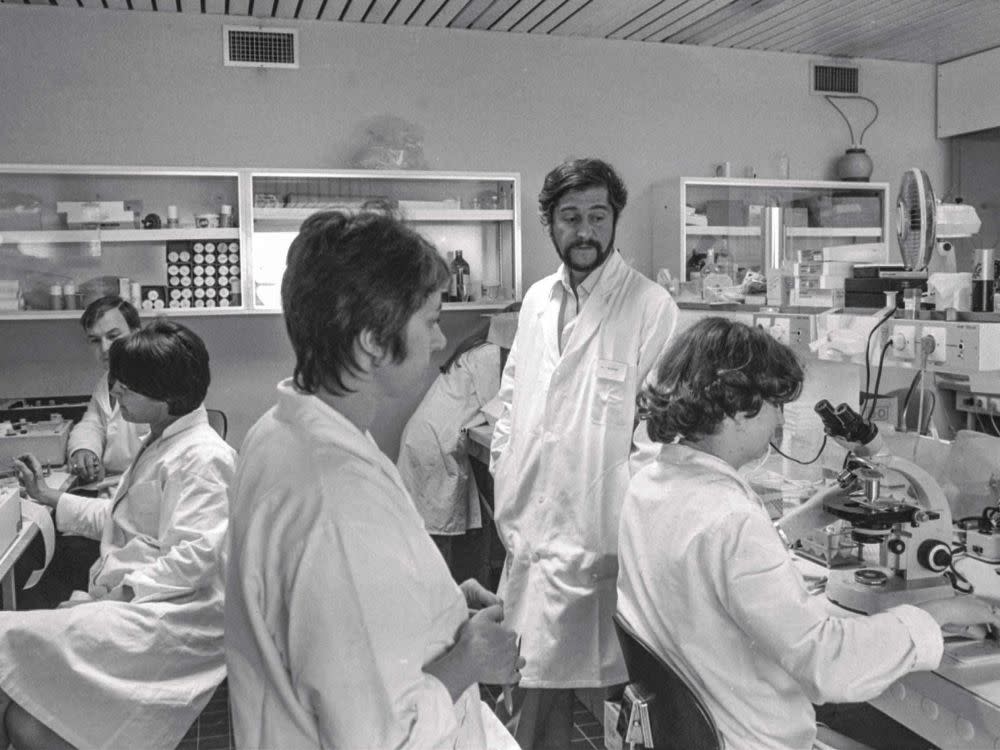
Calorique, rayons N, éther ou fluide boréal expliquant les aurores polaires... L'histoire des sciences est pavée de théories qui ont connu un certain succès avant de tomber aux oubliettes. Autant d'impasses qui gagneraient pourtant à être davantage étudiées... pour savoir ce qu'il ne faut pas faire.
Cet article est issu du magazine Les Indispensables de Sciences et Avenir n°212 daté janvier/ mars 2023.
La science n'est pas un long fleuve tranquille. Son cheminement est au contraire sinueux, chaotique, conflictuel. Périodiquement, de nouvelles théories surgissent, séduisent plus ou moins… et ne passent pas l'hiver. Parfois, celles qui faisaient consensus butent sur des phénomènes qu'elles sont incapables d'expliquer, et finissent par être remplacées.
Que deviennent-elles ? "Les anciennes théories restent utiles, note l'historien des sciences Olivier Darrigol, de l'Université Paris-Cité. Certaines survivent notamment parce qu'elles permettent des calculs plus simples que celles qui leur ont succédé. En avionique, par exemple, la mécanique classique de Newton est parfaitement efficace."
Autre exemple : on a longtemps expliqué les échanges thermiques par la circulation d'un fluide appelé calorique. "C'est le physicien écossais Joseph Black (1728-1799) qui propose cette théorie impliquant un fluide s'écoulant des corps chauds vers les corps froids", raconte Jean-Marc Ginoux, qui enseigne l'histoire des sciences à l'École centrale. Aujourd'hui, on explique la chaleur par le mouvement, à l'échelle de l'atome, mais si un chauffagiste voit la chaleur comme un fluide, a-t-il tout faux ?
"En science, il y a 'faux' et 'faux', assure Olivier Darrigol. Jean-Marc Lévy-Leblond a publié en 1980 un bel article titré 'Éloge des théories fausses', lesquelles, selon lui, devraient être enseignées afin que les étudiants apprennent à les réfuter." Pour le grand physicien, "l'histoire traditionnelle des sciences et de leur succès est celle de la seule partie émergée d'un iceberg, qui ne flotterait pas s'il n'était soutenu par un volume beaucoup plus grand d'échecs et d'erreurs". Il ajoute : "Maîtriser un concept scientifique, c'est connaître les limites de sa validité, donc reconnaître les situations où il n'opère pas."
Jean-Marc Lévy-Leblond propose dans cet article une "typologie so[...]
Lire la suite sur sciencesetavenir.fr

 Yahoo Actualités
Yahoo Actualités 
